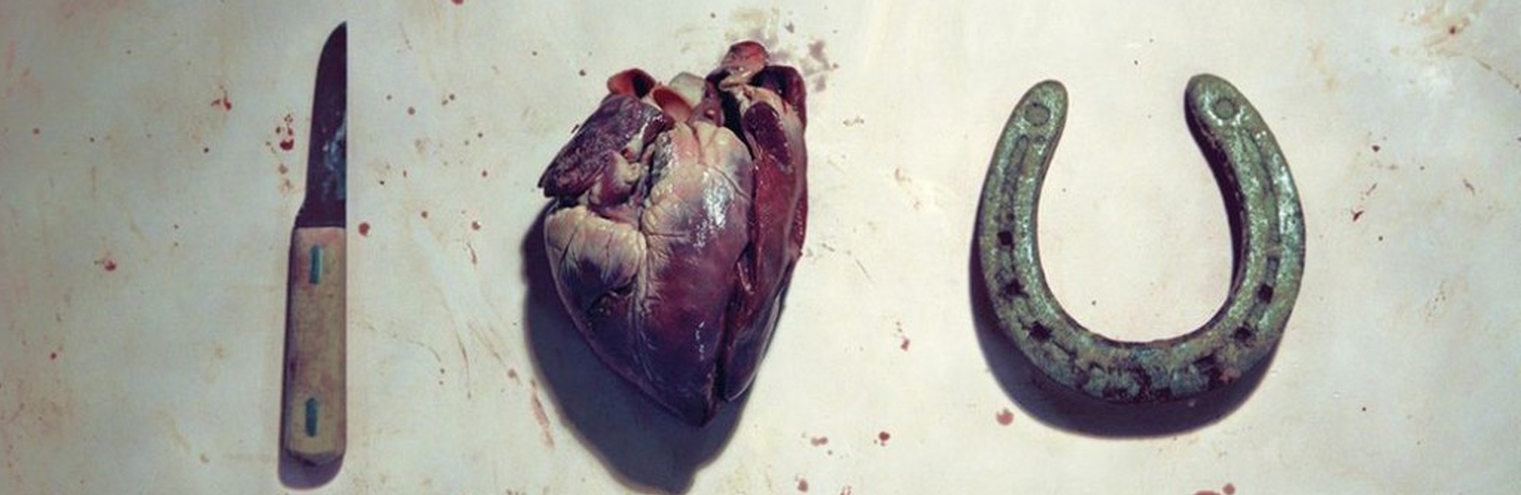La vérité
Prologue
L’administration a dressé une liste précise et exhaustive de toutes les maladies qui donnent à ses employés le droit d’obtenir un Clm. (congé longue maladie) et de continuer ainsi à percevoir tout ou partie de leur salaire.
Parmi ces maladies, il y a la dépression.
Cependant, il n’existe aucune statistique officielle sur le nombre d’enseignants en dépression.
2020
En mars, je fus convoqué chez le médecin-expert. Je roulais dans une espèce de purée de pois. Le ciel était gris comme s’il faisait nuit en plein après-midi. Je peinais à trouver l’endroit de mon rendez-vous. Je conduisais le nez collé au pare-brise. Les essuie-glaces tournaient à plein régime sans pour autant parvenir à évacuer la grosse giboulée qui dégringolait, inondant les bas-côtés de cette route en rase-campagne. Je n’y voyais rien et je commençais à paniquer, d’autant plus que dans ma vieille fourgonnette je n’avais pas de Gps. J’avais étudié la carte avant de partir mais j’avais oublié de l’emporter avec moi. D’ailleurs, je me demandais si c’était bien moi qui la conduisais cette satanée fourgonnette. Je pensais à un film américain des années 90, dans lequel le héros est dans une ville qu’il ne connaît pas, le bras en sang, flingué par un tueur méchant et déterminé, grimpé dans un énorme quatre-quatre. A un moment, le héros blessé sort d’une main un plan de la ville qu’il déplie sur le tableau de bord tandis qu’il continue à piloter sa voiture de l’autre main. On se demande comment. Et il file, plus vite, slalomant dans des ruelles tellement étroites qu’on se dit qu’il ne va jamais réussir à s’échapper. Mais le type est très concentré, la sueur perle sur son front, il cligne des yeux, penché sur la carte. Très gros plan, coup de volant, musique à fond. Voilà le héros engagé dans la bonne direction et le tueur dans le quatre-quatre, semé.
Moi, je ne suis pas un héros. J’avoue que cette convocation me perturbait, d’autant que se décidait mon maintien hors de la salle de classe et la prolongation de mon Cml. Sans mentir et sans être Américain, car ils n’ont peur de rien les Américains, j’avais le sentiment de jouer ma peau. De circonvolution en circonvolution, je finis par deviner, à la perpendiculaire de la route départementale où je galérais, sur une espèce de plateau, un ensemble de pavillons au milieu d’un bois. Je m’engageai dans un chemin de terre et de graviers. Sur une pancarte, il y avait écrit : Clinique Psychiatrique.
Je me garai.
Je marchai ensuite le long d’une palissade derrière laquelle j’entendais des gens chanter. J’étais curieux de savoir d’où cela provenait. A travers les interstices, en me haussant sur la pointe des pieds, manquant de me vautrer dans le fossé, je lus sur un panneau, au-dessus de la porte d’un des pavillons : Ateliers d’expression. Je fis le tour à la recherche de l’entrée principale. J’étais inquiet. Je finis par arriver au portail.
– Michel Mottro, dis-je à l’interphone.
Un parc arboré s’étendait devant moi. Au milieu, sept vieux séquoïas. Autour, debout, à côté de bancs aux lattes gondolées et à la peinture écaillée, des groupes de femmes et d’hommes à moitié débraillés. Qui s’assoit sur les bancs à part les amoureux ? Les vieux et les clochards ? Les fous ? Ils parlaient en gesticulant. Tous tétaient des cigarettes. Quand je passais à côté d’eux, leurs têtes vrillèrent de mon côté, dans une chorégraphie mécanique. J’accélérai le pas vers le bocal des infirmières.
L’une d’elles m’indiqua où était le docteur-expert. Je franchis un couloir interminable. Je croisai un grand type qui trimballait une liasse de papiers dans un maroquin vert qu’il agitait en bredouillant :
– La vérité, la vérité, elle est ici, la vérité !
Il portait un Perfecto et des Santiags éculées. Il accrocha mon regard, s’arrêta un bref instant et me dit :
– Salut, mec !
Je ne lui répondis pas car j’étais préoccupé par mon rendez-vous. Pourtant, quelque chose me turlupinait. J’aurais voulu lui demander si on se connaissait. Il aurait pu être moi, j’aurais pu être lui. Je bifurquai et j’allai m’asseoir en face de la porte du toubib. J’en profitai pour piquer un petit roupillon quand surgit une espèce d’échalas. Il tenait à peine sur ses jambes, titubant, manquant d’écraser le bout de mes bottes. Il m’apostropha avec un accent nasillard.
– N’avez pas vu le docteur Vêt ?
– Non, pas encore, lui dis-je.
– Ah bon… Moi c’est Kévin, et toi ?
– Qu’est-ce que ça peut te foutre ?
– T’es méchant.
Il partit, la tête penchée, le regard de travers, le sourcil épais et brousailleux, la mâchoire en avant, prête à mordre. Un autre type, à la démarche de danseur, s’approchait, comme surgi de nulle part. Il portait une veste noire à col mao, un pantalon en daim et des mocassins.
– Bonjour monsieur. C’est vous le prof ?
– Oui, bredouillé-je.
– Je vous demande un instant.
Et il s’engouffra dans son bureau, le docteur Vêt, suivi de Kévin, tout tremblotant. J’eus à peine le temps de me rendormir. Je vis le médecin-danseur dans le couloir avec, derrière lui, le drogué qui pédalait dans tous les sens, brinquebalant sa caboche, moulinant ses bras tendus vers une feuille que le type brandissait tel un appât. Enfin, j’entendis comme un air de pipeau.
– A nous, dit le psychiatre, en m’invitant à entrer,.
Il se cala derrière une table sur laquelle il n’y avait rien d’autre qu’un stylo-bille, une règle et un sous-main. Il virevolta sur son tabouret, se retourna vers une étagère, saisit un dossier, le posa devant lui, l’ouvrit, se mit à lire avec de petits mouvements saccadés, de gauche à droite, de droite à gauche, se secouant le chignon. Il leva ses yeux au plafond, les descendit sur moi. Puis, s’arrêta.
– C’est mon confrère, le docteur Ahat, qui vous suit ?
– Pardon… Oui ! Depuis plusieurs années.
– Bon, j’ai pris un peu de retard dans les rapports que je dois livrer au comité médical. Impossible à joindre, ce foutu comité, personne n’est responsable de rien dans votre administration. Bref, ce n’est pas précisé dans votre dossier, dites-moi, quels médicaments prenez-vous ?
– Dépamide, Lexomil, Atarax, Euphon…
– En quelle quantité ?
– Deux Dépamides par jour, un demi Lexomil, un Atarax de temps en temps, Euphon matin et soir, enfin, surtout le soir.
– Oui… Pas grand-chose, vu votre gabarit.
– Vous savez monsieur, je me demande ce qui pousse un humain à se rendre chaque jour mordicus dans un endroit où il sait qu’il risque sa vie. J’en ai parlé au docteur Ahat et…
-Il est psychiatre et psychanalyste, le docteur Ahat ?
– Oui, monsieur. Pourquoi ?
Il commençait sérieusement à me courir, Maurice Béjart.
Il ne moufta pas. Il observait ma surprise, mon air ahuri. Il relut mon dossier vite fait et déclara:
– Ils ne disent pas grand-chose, les psychanalystes…Bon, c’est leur métier… N’ayez pas d’inquiétude, il est très compétent mon confrère. Rassurez-vous, je ne vais pas aller contre son avis.
– Oui, je me souviens, le docteur, il avait évoqué, une fois, les empêchés de penser. C’est ça ! Les empêchés de penser qu’il disait en parlant de mes élèves de collège…
– Intéressant cette appellation, vous permettez que j’en prenne note ?
-Oui, je vous en prie. D’ailleurs, il m’avait conseillé la lecture d’un ouvrage intitulé…
– Bon, monsieur, je n’ai pas trop le temps, si vous voulez que je remette mon rapport au comité médical dans les délais.
Le toubib se leva alors avec une telle souplesse et une telle vivacité que je me sentis immédiatement soufflé vers la sortie. L’entretien avait duré cinq minutes. C’est tout. Pas grand-chose, quoi !
– Merci monsieur, content de vous avoir connu ! qu’il m’avait dit Béjart juste avant un dernier entrechat. Reposez-vous surtout, qu’il avait ajouté. Mais le repos, ce n’était pas dans mes projets.
2015
Cette année-là, j’avais été muté au collège « shit-party » de l’académie, ainsi que tous les profs le surnommaient. D’après l’infirmière, 80 % des collégiens fumaient des joints, deux par jour. Au moins. A chaque récréation, on voyait des masses de mômes s’éparpiller vers les toilettes, dans tous les recoins et les cachettes de l’immense cour. Et tandis que les élèves se mettaient bien, comme ils disaient, les profs, pour éviter d’avoir mal, s’enfilaient des quarts de Lexo qu’ils piquaient du bout des doigts dans de minuscules boîtes en plastique vert.
Moi, j’avais une classe de caïds, des troisièmes T. avec de vraies têtes de gagneurs, cheveux ras, oreilles dégagées sur les côtés, fronts bas. Dès neuf heures le matin, la plupart avaient les yeux rouges, complètement éclatés. Les retardataires, ceux qui entraient en classe dix, quinze minutes après la sonnerie, poussaient la porte d’un coup de pompe, et, avant d’aller s’asseoir, prenaient le temps de serrer la main de leurs potes, de tous leurs potes. Et comme ils étaient tous potes, pour l’occasion, il y avait un drôle de remue-ménage. Parfois, il y avait une échauffourée pour une place déjà occupée. L’occupant, en général, cédait après quelques invectives du genre : « dégage, sinon je te marave ta sale tronche de bâtard ». Des chaises volaient. Rarement les tables. Grâce à tout ce chahut, je gagnais une bonne demi-heure de cours. Enfin, de cours, c’est vite dit, car, après quelques injonctions qui ramenaient deux ou trois minutes de quiétude : « maintenant, on bouge plus, on se tait ». Puis : « maintenant, on sort son cahier et de quoi écrire ». Le bordel repartait de plus bel : « m’sieu, chais pas écrire » ou : « m’sieu, j’ai pas de cahier ».
Quatre matinées par semaine, un TER, train express régional, me larguait à deux kilomètres du bahut. Je me coltinais pédibus le chemin depuis la gare. Plus je me rapprochais, plus j’entendais sourdre une tempête sonore de cris, de rire et de hurlements.
A force de rencogner tout ce vacarme au tréfonds de ma carcasse, il m’était devenu impossible de contenir la fureur accumulée. Un matin, alors que j’avais déjà tourné trois fois dans la salle de classe, expliqué, articulé, reformulé, la façon dont il convenait de lire les consignes, pourtant faciles à comprendre, j’explosai. Les trente ados dont la moitié avait triplé au moins une classe à l’école primaire, étaient soit vaguement hilares, soit apathiques, parfois en proie à des accès de questionnements improbables , ostensiblement hors-sujet : « monsieur, vos bottes, c’est ringard », « hihihi… t’as vu le cow-boy ». Ca coassait dans mon dos. Il me fallait beaucoup de concentration et de retenue pour continuer à parler dans un tel espace saturé de bruits et d’hostilité. J’avançais pourtant bien campé sur mes deux jambes mais je me sentais comme une bête en cage. Mon esprit était de plus en plus vacillant, j’avais un de ces mal au crâne qui me tenaillait à la limite de l’implosion. Je me disais que je m’étais tapé cinq années d’études supérieures, un concours difficile, des inspecteurs sadiques, des mutations au hasard de programmes informatiques délirants. Tout ça pour en arriver à cet instant où, n’en pouvant plus, je posai mon avant-bras droit sur la pomme d’Adam du garçon assis dans le fond, le plus dégingandé, le plus insignifiant. Et mon bras gauche entre ses omoplates. J’avais joint simultanément mes deux mains, pouces et doigts serrés, calé mon front contre sa nuque. Le branleur était bloqué sur sa chaise. Heureusement car, déplié, il devait faire une tête de plus que moi. Je jetai ma jambe sur la table et poussai son nez sur mon pied. Son nez bien écrasé : « alors, qui c’est le ringard ? ». Je l’entendais qui se raclait la gorge. J’étais en train de l’étrangler. Et dans la salle de classe, il y eut subitement comme une distorsion de l’espace-temps.
La sonnerie de la récréation me ramena au présent. Je lâchai mon étreinte pendant que toute la troupe se barrait. Le jeune type tourna vers moi un visage écarlate. Il me semblait voir quelques larmes dans ses yeux. Je le crus un instant. Un instant seulement car ce n’était pas de la tristesse ni du regret. Son œil larmoyait à force de crispations et m’envoyait comme des tirs de roquettes. S’il avait pu, il m’aurait dessoudé. Son voisin de table avait déguerpi avec la bande. Nous étions seul, lui et moi dans cette salle où surnageait une odeur de vestiaires pourris, de crasse et de moisissure.
– Je peux y aller, m’sieu ? demanda-t-il , froidement.
– C’est ça, vas-y, casse-toi !
La chaise était libre et je m’y assis en m’écroulant presque. La tête me tournait. Je voulus me lever mais c’était impossible. J’avais la sensation de peser une tonne. Comment allais-je reprendre normalement la conduite de la classe ? Je m’étais emporté, pris d’une pulsion assassine. Mais je pensais qu’il s’agissait aussi de légitime défense. C’est pourquoi, je me traînai en direction du bureau du principal, Gérard Daubeuc. Le mec se la jouait cool, à tu et à toi avec les profs. Ambiance start-up. Je lui racontais mon histoire avec un tremblement dans la voix et même s’il n’était pas beaucoup plus âgé que moi, j’en appelais à ses conseils et à sa protection. C’est avec un sourire de hyène qu’il me répondit, Gégé.
– Tu vois Michel, il faut que tu apprennes à bien différencier le Michel que tu es… et ton rôle de prof. Et là, tu as tout mélangé, tu t’es laissé allé. Manque de professionnalisme… Bon, bon, je considère que c’est une faute de débutant, en tout cas, avec des jeunes en situation d’échec scolaire qui ont besoin d’attention et de bienveillance. Il faut que tu trouves la bonne distance, Michel, la bonne distance…
2020.
Le jour d’avant le premier confinement, celui qu’avait décidé le gouvernement pour éviter la propagation du virus Covid 19, je restai planqué au coin du lycée, me déplaçant discrètement de portes cochères en recoins sombres, faisant le pet, camouflé, masqué. Au bout d’un temps qui me sembla plus long que prévu, il apparut sur le perron côté entrée du personnel : le proviseur, en costume Smalto havana bleu. Après avoir pris une longue inspiration, rentré son ventre, il se lança, traversa la rue et s’engouffra dans la venelle en face. Vite, je le suivis. Il était en goguette, cheminant vers les bureaux de l’inspection académique, comme tous les vendredis matin. Le passage était étroit, La ville déserte, en proie à une grande solitude. J’étais juste derrière lui. Sans doute qu’il sentit ma présence.
Brusquement, il se retourna. J’eus un instant de frayeur, croyant qu’il m’avait repéré, allant même jusqu’à imaginer qu’il lisait dans mes pensées. Il faut dire que je l’avais bien connu, Gérard Daubeuc, à ses début, faux-cul, ambitieux, servile avec les puissants, impitoyable avec les faibles.
Je le cueillis sans difficulté, le poussai sur le matelas installé à l’arrière de la fourgonnette garée discrètement à la sortie de la venelle. Simplement se baisser, déséquilibrer, tirer, projeter. Kata-Guruma en japonais, troisième lancement d’épaule au judo. Puis je m’installai à côté du kidnappé, fermai la portière et tirai les rideaux tandis que Morgane démarrait. Morgane est ma complice, mon alter-égo, ma sœur. A peine avait-elle passé la seconde que Daubeuc se mit à hurler. Il goûta aussi sec le bout de ma botte et partit valdinguer.
– Même pas mal…
– Maintenant, tu vas la fermer ou tu vas encore te manger un coup de saton !
– Oui, monsieur… mais où m’emmenez-vous ?
– En ouikène au vert, à la campagne. C’est pourquoi tu vas tout de suite téléphoner à ton adjoint d’abord, ensuite, à ta gonzesse. Tu vas les prévenir qu’un imprévu t’oblige à passer un petit moment avec tes grands enfants qui ont tant besoin de ta présence. Pour tout le monde, tout va bien, pigé ?
– Comment vous savez que j’ai des grands enfants ?
– Parce qu’on est bien renseigné, ducon !
La plus rude à convaincre fut Pépita, sa nouvelle femme, une jeunette, qui, inutile de vous le préciser, n’avait pas épousé Daubeuc pour ses beaux yeux mais parce que le chef d’établissement, en réalité chef de bâtiment, jouit d’une position privilégiée et bien protégée au sein de l’institution scolaire. Donc, son portable vibrait, ça branlait dans tous les sens. On l’entendait qui vociférait à l’autre bout du fil, Pépita « mi corazon ». Elle était vindicative et carrément vulgaire :
– Tu vas encore longtemps leur torcher le cul à tes deux ados boutouneux ?
– T’inquiète pas mon amour, c’est juste pour quelques jours.
Mais Daubeuc était rusé. Il profita d’une pause pipi pour se carapater à travers un petit bois. Il décanilla à fond les ballons, zigzagant entre les arbres. Il était tellement véloce qu’il ne put éviter une branche basse qui accrocha sa moumoute. Drôle de nid. C’est là qu’on le rattrapa et qu’on le recolla dans la camionnette, manu militari.
Malgré sa tête de schbeb, il lui restait quand même quelque chose d’outrecuidant à Daubeuc. Même s’il ne voulait pas savoir qui nous étions, il avait sa petite idée, qu’il raillait, nous observant derrière ses lorgnons tordus. Alors je les lui arrachai et les pétai sous le talon de ma botte.
Nous nous remîmes en route pour Celles-sur-Belle. Beau port de mer, ironisait Morgane. L’avantage, c’est que nous n’avions aucun risque d”être inquiété par quiconque. Il y avait belle lurette que la seule agence immobilière avait fermé. Les maisons du bourg étaient preque toutes inhabitées, sauf l’été. Avec Morgane, nous avions hérité de la pharmacie de nos parents, vieille de plus d’un siècle. Nous nous occupions à la restaurer. Et nous en avions encore pour cent ans.
2015
L’époque où l’on collait les bavards au coin, un bonnet d’âne sur la tête des idiots, des coups de règles sur les doigts des insolents, était révolue. Les élèves étaient devenus nos maîtres. Aussi, je redoutais les conséquences de ma reprise en mains virile, façon étranglement. J’imaginais une action juridique, un procès craignos intenté par des parents hargneux, ma carrière ruinée. Je me faisais un sang d’encre, des films d’épouvante. C’est pourquoi je me décidai à parler au mec du SNAC, le syndicat national des collèges, un type maigre, noueux et barbus, alternant survêtement et costard-cravate, roulant dans une grosse berline , passionné de « footing », le matin avant le boulot, le soir après. Il poussait le dix mille mètres autour de la piste d’athlétisme du bahut sous les regards moqueurs des filles de troisième qui lui trouvaient l’air d’un beauf sans rien en laisser paraître, les pétasses !« vous êtes rudement rapide monsieur Fossemel et musclé, vous irez bientôt aux Jeux Olympiques… ». Jean-Noël Fossemel, qu’il se nommait, le syndicaliste, un prof de maths, ancien collègue de Gérard Daubeuc.
– Avant, Gégé, quand il était prof, il était marié avec un tromblon, je te raconte pas…Une fois chef d’établissement, il a viré sa grosse et ses drôles, pour se mettre à la colle avec une petite, tu vois qui c’est ?
– La conseillère d’éducation, Pépita, mais elle est beaucoup plus jeune que lui !
– Ben ouais, c’est pour ça qu’ils veulent devenir chef, ça attire les gonzesses.
– Et mon affaire ?
– Faut d’abord que tu prennes ta carte.
– Ah bon ? Je croyais que vous défendiez tout le monde…
– Avant, oui… Seulement, nous, les délégués, tu comprends, on bosse pour des prunes, alors, on en a marre d’aider des gens ingrats. Maintenant, faut raquer.
– Je comprends, mais l’adhésion, vos tarifs, ce n’est pas donné !
– C’est proportionnel à ton échelon. Question de justice sociale, plus tu gagnes, plus tu cotises. Tu peux payer en plusieurs fois. Fais-moi donc trois chèques, par exemple.
Justice sociale, tu parles ! Fossemel s’activait secrètement, comme un prisonnier prépare son évasion, pour devenir permanent syndical au bureau national et cesser d’enseigner les maths.
Il y eut donc une entrevue officielle avec Gégé. Je me tenais assis droit, le dos plaqué contre le dossier de ma chaise, les mains posées sur mes genoux. J’essayais d’être zen.Je comptais le nombre de mes respirations. Je ne réussis qu’à compter cent trente pulsations cardiaques par minute. J’étais proche de l’infarctus.
Je découvrais que Daubeuc et Fossemel étaient comme deux larrons en foire bien que le camarade syndiqué me lançât de temps en temps des signes de connivence, plutôt des grimaces. Au bout du compte, je risquais un blâme ou, qui sait, une mise à pieds, sans salaire, rétrogradé. J’étais en train de vivre un moment flippant. J’avais la gorge serrée, la bouche sèche, je transpirais. A vrai dire, je n’entendais même plus ce qu’ils se racontaient, ces deux peigne-culs. J’arrivais à faire ça, parfois, à m’extraire, à voyager mentalement, du plus proche au plus lointain, jusqu’à survoler la terre entière. En général, ça me rendait terriblement mélancolique de contempler le monde d’en haut. Et cette fois-ci, j’en pleurais.
Il me sembla que j’étais parti très loin avant de redescendre face à Daubeuc bien installé derrière sa table de bureau, les coudes plantés dans une masse de paperasses.
– Michel, Michel ! T’es avec nous ? braillait Fossemel.
Non, je n’étais pas avec eux. Je m’obligeais, question de survie.
– Oui, qu’est-ce qui se passe ?
– Tu vas signer ce document, c’est ta demande de mutation.
– Et pourquoi ?
– C’est la condition pour t’éviter pas mal d’emmerdements.
Je n’en pouvais plus d’entendre ce gros tas de Daubeuc tournicoter sur son siège qu’il faisait exprès de faire grincer. Il avait aussi une espèce de tremblement d’impatience, une sorte d’agacement. J’étais tellement éberlué que je n’avais pas réalisé qu’il me tendait un stylo-plume, un Parker plaqué-or. Je le lui arrachai presque des mains et signai, non sans avoir, au préalable, laissé inopinément tomber le stylo sous la table. En le récupérant, j’écrasai la plume sur le lino, remis le capuchon et lui rendis son stylo.
L’hiver n’en finissait pas. Je me levais tôt, je rentrais tard. Je naviguais la nuit dans des trains éclairés constamment par des néons d’où jaillissait une lumière jaunâtre. Au collège, plus personne n’osait m’adresser la parole. Gérard Daubeuc s’était mis à arpenter le couloir le long de ma salle de classe, m’adressant des sourires pincés quand j’arrivais. Je remarquais qu’il y avait moins de chahut dans mes cours. Mais je sentais que les collégiens me mataient en silence et j’entrevoyais de futures représailles. Je les imaginais comme des rat à l’affût dans les combles, prêt à me tomber tous dessus, d’un seul coup. Je voulus ainsi en parler à Fossemel puisqu’il n’y avait plus que lui, susceptible de me répondre. Pas de bol ! il était absent, pour des raisons syndicales, disait-on. Personne ne savait vraiment. C’est comme ça que je me confiais à une collègue, oubliant la nature perverse de l’environnement humain dans lequel j’évoluais. Janet Willmot était la seule prof d’anglais du collège qui n’avait pas encore pété les plombs. Elle avait l’habitude de me serrer dès qu’elle m’apercevait, à la cantine, à la machine à café, toujours prête à me dépanner d’un peu de monnaie, me sussurant des Mickaël sur au moins trois octaves. Parce que la Sncf avait annoncé des grèves, je me mis à chercher un refuge temporaire sur place. J’acceptai ainsi l’invitation de Janet qui me proposait un clic-clac dans son modeste deux-pièces, rien de luxueux, du dépannage à la bonne franquette. Quand elle prononça clic-clac, je crus entendre crak-crak. Alors, j’observais de plus près sa bouche étrange aux lèvres peinturlurées bleu-cobalt, ses grandes dents blanches aux gencives bombées. Elle avait quelque chose du chameau, avec une chevelure orange, de larges yeux marrons. De quoi stimuler mes fantasmes, susciter l’investigation. Et je ne fus pas déçu du voyage !
A peine m’étais-je installé, qu’elle surgit dans son salon en combinaison ras-la-moule, fanfreluches, escarpins et bas résille. J’eus aussitôt la gaule et dépliai le canapé. Nous nous papouillâmes, nous roulâmes des pelles.
Elle quitta son attirail et commença à se déchausser de ce qui visiblement, lui comprimait les orteils. Je pressentis alors quelque chose de bizarre. Je guettais ses pieds, supputant la présence d’un monstrueux hallux-valgus. Que sais-je ? Pire encore ! Oui, elle avait de gros oignons sur chaque arpion, des doigts de pieds comme des tentacules qui se détendaient l’un après l’autre. Je me demandais si elle n’était pas en train de se métamorphoser. Timidement, je lui suggérai de revenir à elle, de reintégrer ses tatanes, que nous pouvions voir le film à la télé, car, question quéquette, pour moi, c’était râpé !
Elle le prit mal, Janet. « It’s a shame, it’s a shame ! » qu’elle répétait sans arrêt, si mal que le lendemain, je dus louer une piaule à l’hôtel de la gare. La gare c’est là, comme disait ma grand-mère.
2020
Avec le confinement, une chappe de silence avait recouvert le pays tout entier et notre village se réchauffait douillettement dans une douceur retrouvée. Dans la campagne, partout, l’herbe avait repoussé drue, grasse, plus verte. Sur les chemins, il y avait des tapis de paquerettes, des coquelicots, des marguerites. Jamais le chant des oiseaux n’avait été aussi varié, ample et net. Piaillements, roucoulements, jacasseries dans les taillis. Sur la route départementale qui passait derrière la maison familiale, le flot de la circulation automobile s’était totalement tari. Fin des vrombissements, des fumées et des miasmes. Au-dessus des toits , le ciel était toujours bleu comme un lac de montagne.Les activités humaines étaient presque toutes suspendues. On allait se ravitailler dans la zone commerciale, muni d’un laissez-passer dont on reproduisait à chaque fois le libellé afin de le présenter lors d’un éventuel contrôle de la gendarmerie. Sauf que, la maréchaussée, on ne la voyait jamais. A croire que les pandores se planquaient craignant d’être contaminés.
Nous enfermâmes le proviseur dans une pièce insonorisée. Nous y avions fixé et rembourré, un ampli maousse. C’était du matériel indéboulonnable, indestructible. Depuis la salle à manger, à côté, sur une table de mixage dernier cri connectée à une platine, je commençai à lui envoyer du gros son, à Gégé, des stridences inaudibles, des déferlements de chiottes qui fuient, des bruits de chasses d’eau détraquées, comme ceux que j’entendais dans la salle de classe du rez-de-chaussée où j’avais été autrefois exilé. Je le fis bondir au plafond, l’enflure de Gérad. Il allait se précipiter sur les murs, se cogner la tête contre les tentures. Des heures durant, Je lui balançais en boucle le bourdon déchaîné de Notre-Dame, les sirènes amplifiées des pompiers après le grand incendie, les cymballes de Boulez avant son dernier concert, celui-là, juste avant qu’il clamse. Je voulais que cette raclure regrette, qu’il éprouve à son tour, la terreur invasive du bruit contre lequel on ne peut rien et que moi, j’avais dû supporter durant tant d’années : bavardages, cris, éclats de rire, invectives, projectiles balancés au tableau quand j’avais le dos tourné.J’allais régulièrement vérifier les effets que produisaient mes enregistrements sataniques. J’entrouvrais la porte matelassée du studio. Je l’observais qui se tortillait, le cloporte, s’approchant à moitié claudiquant.. A chaque fois, je lui demandais : ça va ? Et ça le rendait furieux. Il s’ébrouait, éructait, crachait dans ma direction et son glaviot lui revenait en pleine tronche. De rage, il plongeait vers mes jambes, espérant m’agripper et me plaquer au sol. Mais il était trop faible pour y parvenir. Je le laissais s’affaler et le retournais comme une crèpe. Il se mettait à gémir, à pousser de petits grognements, à agiter dans le vide ses bras trop courts et ses jambes grèles. Bête hideuse. Et tandis que je repartais vers la salle à manger, je sentais encore la vibration du son sur le plancher, juste sous mes pieds.
2015
Je fus muté d’office dans un lèp, un LP, ça veut dire lycée professionnel et là, personne ne veut y aller ! Lycée professionnel égal poubelle, disent les élèves qui y sont orientés après le collège, le plus souvent contre leur volonté. Idem pour les profs. Celle-là, de poubelle, ressemblait à une cathédrale néo-gothique dans le style Eiffel, de la ferraille monumentale ! En attendant qu’on vienne me chercher dans la nef de l’entrée, je faisais les cent pas tout en regardant, à en choper le torticolis, les poutrelles en acier, le plafond et toutes ses ampoules qui éclairaient en plein jour. Je me disais que pour changer ne serait-ce qu’une de ces ampoules, et il y en avait des centaines, la seule solution était d’appeler les pompiers avec leur grande échelle.
Je fus reçu par le proviseur, Yvan Lebonpin. Véridique, c’est comme ça qu’il s’appelait. Les profs le surnommaient, je l’appris ensuite, Pabon parce que la bouffe de la cantine était degueulasse et pour les profs, la cantine c’est important car, pour eux, il n’y a pas de ticket-restaurant.
Mais il n’allait jamais y déjeuner, Lebonpin, sauf à Noël, pour un repas d’exception dont il établissait lui-même le menu. Le reste du temps, il ne se mêlait de rien. Tout l’indifférait, sauf son bureau dont il sortait rarement. Une sorte de loft, d’au moins trente mètres carrés, meublé high-tech par sa femme, architecte d’intérieur, toujours à l’extérieur, en voyage d’affaires. Il vivait en solitaire, le proviseur, entre les quatre murs de son bureau, enduits d’une peinture façon rocaille, couleur coquille. Nous nous assîmes à une grande table rectangulaire en verre blindé et acier chromé, chaises en titane. C’était léger. Au milieu, trônait une imposante banquette en cuir patiné. A côté, une machine à café flambant neuve, de celles qu’on voyait dans les pub à la télé avec Clooney.
– Nespresso monsieur Mottro ?
Je faillis répondre What-else ? mais il ne m’en laissa pas l’occasion. Il s’empressa de m’apporter une tasse en porcelaine remplie d’un liquide sombre et mousseux.
– Vous pouvez vous servir une petite gourmandise, ajouta-t-il, désignant du menton des chocolats dans un papier de soie rose.
Sur ce, madame la proviseure adjointe, Zora , que tout le monde appelait Zorro car elle avait tendance à abuser du khol de sorte qu’elle semblait porter un loup sur les yeux, comme le cavalier qui surgit hors de la nuit, se déploya dans la pièce.Elle la traversa dans un tourbillon. Deux grandes enjambées qui firent claquer le bas de son pantalon de tergal noir, pattes d’éléphant. Elle souleva une chaise comme une plume, avec trois doigts crochus.
– Un petit café, très chère ? enchaîna Lebonpin.
– Volontiers Yvan, répondit la grande Zora me gratifiant au passage d’un sourire carnassier.
– Monsieur Mottro, vous êtes content d’être parmi nous ?
Non, je n’étais pas content d’être parmi eux. Je faisais contre mauvaise fortune, bon coeur. Je répondis ce qu’il convenait de répondre, avec des hôchements de tête soumis. J’avais d’ailleurs plein de projets éducatifs, en réalité, tous aussi bidons les uns que les autres. Je leur racontais des salades avec un vibrato d’enthousiasme dans la voix. Les deux administratifs me jaugeaient, Zorro en particulierr. Ils se la jouaient bienveillants, conformément aux directives de leur hiérarchie. Là-dedans, tout le monde fait semblant. Donc, je continuai de parler, de meubler leur faux silence. Jusqu’au mois de juin suivant, d’ailleurs, à tous, je parvins à fourguer mon baratin, non sans des efforts qui, à force, devinrent douloureux. Le lycée était réputé pour son pôle audio-visuel, sa section « Techniques de l’image numérique » censée préparer au futur métier de photographe, métier sans avenir vu que n’importre quel baltringue pouvait être photographe sans avoir à se taper trois ans de bac-pro. Les profs de photo faisaient abonder, ils multipliaient les sorties pédagogiques, les voyages à l’étranger, accumulaient des heures sup. Ils se prélassaitent comme des lézards visqueux dans une sinécure technologique clinquante et onéreuse. Tout cela aux frais du contribuable. Les élèves attendaient de passer le bac, sentant bien l’arnaque. Ils s’énervaient, par à coups, mais sans jamais oser s’en prendre directement aux escrocs, à leurs profs de photo. Alors, c’est les collègues qui dégustaient, ceux de l’enseignement général. Moi, j’étais chargé des cours de communication. On ne disait plus ni lettres ni français dans le nouveau lycée des métiers. Pourvu qu’on communique ! C’est comme ça que je finis par tourner bourrique. Les profs se la jouaient, genre : j’expose à Paris, j’ai une succursalle à Arles. Les petits photographes aussi, fils et fille à papa, arrogants, ignorants, incapables d’intégrer une seconde générale, ambitionnant de devenir shooteur dans la haute couture, ils avaient néanmoins atterri dans la poubelle du lycée professionnel. Et ils n’aimaient pas qu’on le leur rappelle. Et moi, j’aimais bien leur rappeler leur bêtise, en loucedé, donnant à tous leurs travaux, même aux plus nuls, les meilleures notes, sans distinction.
– On ne comprend pas monsieur, jamais on a été aussi bien noté. Au lieu de leur répondre : Hé oui, étonnant,non ? Pour une bande de crétins qui ne lisent jamais de livre et savent à peine écrire… Je leur disais sur le ton le plus paternaliste qui fût :
– Comprenez bien que l’enseignement au lycée professionnel est adapté à vos difficultés, le but étant de vous valoriser, afin de vous encourager à progresser.
J’étais devenu le roi des hypocrites, le prof le plus désinvolte de la planète. J’arrivais en retard, les laissant poireauter dans le couloir et je repartais cinq, dix minutes avant la sonnerie qui tintinnabulait, grosse frime, comme celle d’un aéroport international. Je ne refermais jamais la porte à clef. Pas possible. La proviseure adjointe m’avait mitonné un tel emploi du temps de crotte que je n’arrêtais pas de courir, de monter et de descendre les étages de la tour Eiffel, de me faire balader d’une salle de cours à l’autre, trimballant des piles de dictionnaires depuis le CDI, du rez-de-chaussée jusqu’au troisième, si bien qu’un jour, complètement azymuté, je dégringolais, pour de vrai ! Le Samu me ramassa, ratatiné au bas de l’escalier, bâtiment B ou E ?
B comme Burne-Out. E comme Exit.
2020.
On peut toujours fermer les yeux pour ne pas voir le spectacle affligeant d’un monde qui déraille.
Mais difficile de ne pas entendre son vacarme incessant.
On a beau vouloir se mettre du coton, du tissu, des tas d’autres trucs sophistiqués achetés en pharmacie ou chez AudioFon, quand le son est déchaîné, il n’y a rien à faire pour l’empêcher de vous rendre dingue, sauf à se boucher les oreilles avec de la cire brûlante et obtenir ainsi le silence éternel.
Je continuais donc de farcir Daubeuc d’un répertoire de symphonies atonales, de musiques techno-métalliques enregistrées dans des usines désaffectées ou des friches industrielles. On avait l’impression que des légions de forgerons tapaient sans arrêt des coups de marteau sur des fûts en fer. Dans sa pièce capitonnée, le proviseur se morfondait. J’éprouvais un vrai plaisir à le regarder. Une fois, j’eus à peine le temps d’ouvrir la porte qu’il se précipita dessus la tête la première, moitié debout, moitié rampant, s’agrippant à la poignée avec ses grosses mains poilues. Il tourna vers moi sa face de carême, faisant mine d’implorer ma pitié. D’un coup sec, je refermai la porte et il retira ses doigts juste avant que je ne les lui écrase. Il fila à l’autre bout de la pièce, le plus loin possible de l’ampli. Il s’assit en tailleur, se recroquevilla, dodelinant de la tête. Il formulait des paroles absconses qu’il parvenait à peine à éructer.
Gérard Daubeuc était devenu pratiquement muet, limite autiste. Reclus depuis trois jours, ça commençait à poquer là-dedans.
– Passe-le au jet, suggéra Morgane.
En tricot de peau, pantalon chiffonné, sale et pas rasé, il en avait sacrément rabattu de sa morgue, le chef d’établissement. Il touchait presque à l’humilité, espérant se rallier ainsi à l’humanité tout entière, lui gagner un soupçon de sympathie. Mais de ça, je m’en foutais. J’enfonçais fermement l’index et le majeur de ma main droite dans ses trous de nez et le traînai jusque dans la souillarde, derrière la cuisine.
– Désappe-toi, lui dis-je.
– Nan….
– Magne-toi!
Il finit par obtempérer. J’ouvris l’eau à fond de telle sorte qu’il glissa sur le sol pavé, que sa tête heurta le mur et houps ! carpette Daubeuc. Morgane rappliqua à ce moment-là et me dit :
– Faut quand même pas déconner !
Elle me tendit une serviette. Nous l’invitâmes ensuite à partager avec nous quelques tartines de fromage de chèvre accompagnées d’une bouteille de vin du Poitou. Il n’y a pas pire tortionnaire que celui qui alterne supplice et bonté.
Je le raccompagnai ensuite gentiment dans sa pièce capitonnée et lui lançai l’ultime morceau de ma play-list. D’abord, pianissimo. Je me sentais le Torquemada des disc-jokey. Je m’assis à côté de lui et je tapotais son crâne chauve du bout de mes doigts, accompagnant ainsi les claquements secs qui rythment cette fameuse chanson et qui sonnent comme une planche qu’on frappe contre un placard. Ensuite, fortissimo. La chansonnette de variété est d’apparence anodine. On l’écoute sans y penser, dix, cinquante fois par jour, à la radio, à la télé, dans les grands magasins. Elle vous pilonne le bulbe. Et vous ne pouvez plus vous empêcher de vous la fredonner, en cachette, pour ne pas avoir honte de la vociférer en public, même si vous êtes convaincu que c’est la seule manière de vous en libérer, de l’éjecter ad vitam aeternam.
– Donne-moi ta main et prend la mienne.
Enfin, je lui balançai une bonne paires de claques dans la gueule, à Gérard Daubeuc. Et en sortant, j’augmentai le volume. La chanson de Sheila, Annie Chancel de son vrai nom, fut le tube de l’été 1963. Elle se vendit à plus d’un million d’exemplaires. Ce genre de matraquage marque à jamais l’esprit et le système nerveux para-sympathique.
Gérard Daubeuc était le type le plus antipathique de la terre. Le matraquage sonore qu’il subissait n’était que justice.
– Mais oui, mais oui, l’école est finie !
2015
C’est le docteur Ahat qui me sauva. Il portait toujours des chemises à fleurs et des blue-jeans de marque Wrangler. Quelques jours après ma chute, il me reçut dans son étrange cabinet sans aucune fenêtre, aux murs tapissés de tableaux d’art brut, de reproductions de Picasso, d’un grand portrait de Kafka. En haut d’une étagère, une vieille édition des Chants de Maldoror. Plus quelques Moaï en pierre de l’île de Pâques ainsi que de nombreux totem indiens. Heureusement que Morgane m’avait prévenu.
– Tu verras, il est un peu space, il a vécu chez les Hurons au Québec, mais avant, il était chef de service à Lariboisière, c’est un bon !
En souvenir de ce que Morgane m’avait raconté, je le surnommai Big Oreille. J’en avais des choses à déballer. Je percevais sa silhouette recroquevillée dans la pénombre assise sans bouger dans son fauteuil, contre sa bibliothèque. J’avais l’impression qu’il glissait le long de son siège, disparaissant sous l’avalanche de mes mots qui déferlaient à chaque séance. A la troisième, je fus arrêté pour six mois. Bon début. Le combat, cependant, ne faisait que commencer, le combat avec la bureaucratie de la garderie nationale. Bataille sournoise. Surtout, ne jamais sortir de l’ambiguïté car c’est toujours à son désavantage. Retenir ses maux et sa colère. De cette manière, on attrape facilement un ulcère, des cailloux dans la vésicule, une diverticulose sévère, pire, un cancer! En vérité, choisir la maladie mentale, c’est pour faire simple , faciliter les procédures médicales et bureaucratiques avec leur kyrielle de sigles incompréhensibles et leur nomenclature à la mord-moi le noeud. Et obtenir le sésame qui vous sort du bordel.Soyez-en sûr, ce n’est pas vous qui êtes malade, c’est le système tout entier ! La garderie nationale est une maison de fous. Donc, il suffit de lui fournir les certificats qu’elle demande et , roule ma poule!
Ainsi, de certificat en certificat, je me la coulai douce pendant six mois. Puis j’eus droit au fameux CLM. L’administration, en fait, ne dispose guère d’autres solutions pour se débarasser des éléments encombrants.
Officieusement, elle est l’institution publique qui emploie le plus de gens à ne pas exercer le métier pour lequel ils sont payés. Il n’y a pas que les malades, les détraqués du carafon, il y a aussi les profs permanents syndicaux, les profs élus politiques, détachés dans les régions, les départements, les mairies. Sans oublier les TZR, titulaires sur zones de remplacement qui restent chez eux et ne remplacent jamais personne . Et, les inspecteurs généraux honoraires. Tous, payés à faire autre chose que la classe !
Une foule de sauve-qui-peut. Voilà la réalité de la garderie nationale.
En principe, le docteur Ahat ne parlait pas. Pourtant, il me révéla le chiffre de plus de cent mille personnes “en congé”. L’équivalent des habitants de la ville de Niort.
J’avais ainsi réglé le problème de ma culpabilité.
2020
Nous n’avions plus rien à nous dire, plus envie de chanter, ni de parler. Dans le fourgon, Gérard Daubeuc s’était résigné, sagement rencogné dans le siège passager, entre Morgane qui pilotait et moi qui rêvassais. Je ne pus m’empêcher de sifflotter, pour le plaisir. C’était plus fort que moi.
Une fois arrivés devant son lycée, nous le laissâmes filer, le Proviseur. Comme il avait paumé ses clefs et son téléphone portable, il dut passer par l’entrée des élèves, double porte épaisse en acier rouillé terminées par une frise de pics dentelés pointant vers le ciel. Il fallait qu’il fût officiellement ouvert, le portail, même si aucun lycéen ne le franchissait, à cause du confinement. Comme d’habitude, la garderie nationale préservait les apparences.Depuis la voiture, nous observions Daubeuc claudiquant sur les pavés de la cour, comme un marin qui a longtemps navigué et tente de retrouver son équilibre. Au premier étage, du côté de ses appartements, une fenêtre s’ouvrit pour laisser apparaître la trogne renfrognée de Pépita d’où jaillirent ces mots accueillants:
– T’en as mis du temps ! J’ai prévenu la police, faudra que t’aille t’expliquer… Dis donc, t’es drôlement fagoté !
Nous vîmes Gégé s’immobiliser, hésiter, se retourner vers nous, guettant notre approbation avant de continuer le dos courbé, comme s’il portait sur ses épaules toute la misère du monde. Etait-il atteint du syndrome de Stockholm ou bien était-ce parce que que je n’avais pas frappé aussi fort que je l’avais désiré ?
Je me rendis compte que sa vie de Chef de bâtiment n’avait rien d’enviable. Et Pépita ayant révélé sa véritable nature de furie, c’est avec elle qu’il allait se retrouver en tête à tête pendant le confinement. Un confinement, souvenons-nous en, qui déchaîna un nombre incroyable de violences intra-familiales.
Nous sommes en guerre, avait proclamé le Président, sur toutes les chaînes de télévision. Seulement, l’ennemi était un truc microscopique, invisible. Les malades, les presque morts, on ne les voyait que sur les écrans, et pas toujours distinctement, à bout de souffle, intubés, à plat ventre sur leur lit d’hôpital. Et des lits, il y en avait jusque dans les couloirs. Partout, ça débordait. On avait même appelé l’armée qui avait dressé des tentes en tissu camouflage. Hôpitaux de campagne. Au-dessus, sur les images que diffusaient les télés, on voyait d’incessants vols d’hélicoptères qui tournoyaient comme des mouches gigantesques.
Du ventre des avions militaires sortaient des dizaines de malades embarqués sur des civières. On avait l’impression d’une grande débandade. Pour nous remonter le moral, le service public de télévision avait entrepris de diffuser l’intégrale des films de celui qu’il considérait comme le plus grand comique de l’histoire du cinéma français, Louis le Funeste. Celui de ces films qui eut le plus de succès fut Hibernatus.
Moi, il ne me restait plus qu’une chose à faire. Me remettre à fumer car on avait encore le droit d’acheter des cigarettes, beaucoup de cigarettes. Il suffisait de faire la queue devant les bureaux de tabac.
Morgane actionna la clef de contact de la fourgonnette puis se tourna vers moi.
– Dis-moi frangin, t’as d’autres projets ?
– Non, mais j’ai plein d’idées.
– Bon, je te ramène à la clinique alors.
Epilogue
A l’Aire Bleue, une des unités psychiatrique de la Clinique Tasquelles, depuis ma chambre, je contemple le joli enclos, en bas sous mes fenêtres. Gazon parfaitement tondu, entouré d’une contre-allée en terre battue. Au-delà, j’aperçois le parc où s’élèvent en majesté, sept séquoias. Parfois, j’en compte neuf, pour peu que je tourne la tête, que je déplace ma chaise, que j’inspire fort, au cours de mes longues méditations. Je descends l’après-midi sur la terrasse bordant la pelouse, je m’assois à proximité de quelques vieux fous ou jeunes cinglées qui peuvent, d’un seul coup, vous apostropher sans raison, dans un sursaut, un cri primal, un rôt. Il y en a une dizaine, comme moi, ici, en général pour des séjours ponctuels et réguliers. Pas mal de cas sociaux, de gens au bout du rouleau. Les journées sont confortables, réglées comme du papier à musique. On ne se soucie de rien. Cela me rappelle mes jolies colonies de vacances. Le matin, nous descendons à heure fixe pour prendre notre petit-déjeuner au réfectoire. Chacun se sert à un buffet. Il faut, une fois terminé, nettoyer et ranger son bol, passer un coup de chiffon à sa place, sur la grande table commune. Souvent, ça grippe, on s’arrache l’éponge cradingue ou le torchon effiloché sous l’œil impassible de l’infirmier de garde. On ne peut pas dire qu’il nous espionne. La psychiatrie, de nos jours, a quand même pas mal évolué.
Il faut dire aussi, qu’à l’Aire Bleue, nous ne sommes pas des dangereux, plutôt de doux illuminés, des dépressifs, des anxieux.
En général, je passe la matinée dans ma chambre, un endroit propret avec salle de bains et vécés intégrés. Il y a une petite table sur laquelle j’écris. Tout ce qui m’est arrivé, suivant les conseils de Morgane et du médecin coordonnateur. J’ai des blocs de feuilles en papier de luxe que je conserve dans un maroquin vert. C’est parfois douloureux car je perds la notion du temps et j’ai du mal à la retrouver. Cet été là ressemble à une accumulation de banalités collectives, les mêmes que je capte depuis que je suis en âge de m’intéresser au monde alentour, à commencer par les chansons en vogue, laissant à part le hit de Sheila comme événement historique fondateur. Bref, ce mois de juillet ou d’août peut-être, on l’entend partout dans les étages, la chanson à succès de Stromae, Papaouté.
Moi, j’entends surtout le verbe empapaouter. C’est ce que, finalement, j’ai réussi à faire avec la garderie nationale, l’empapaouter. Et oui, à force de courbettes, de renoncement, d’abandon et d’une bonne théâtralisation, je suis parvenu à ce que l’administration transforme mon C.L.M en C.L.D.
Comprenez congé longue durée, avec, cerise sur le gâteau, une mention : maladie psychique imputable au service, qui me donne encore plus de temps, un temps quasi infini, jusqu’à l’âge de ma retraite !
Finalement, qu’est-ce que la vérité ? Une réalité qui dépasse la fiction, une fiction qui dépasse la réalité ou simplement, une histoire qui se termine en chansons.